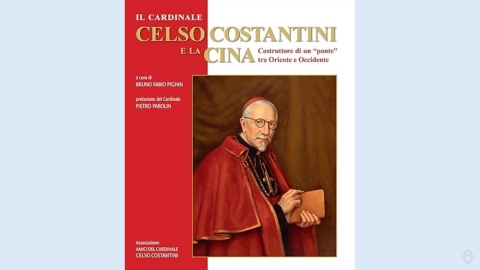France : fin de vie, le mariage des contraires

Assemblée nationale
Alors que les 71 membres de la commission spéciale de l’Assemblée nationale viennent de faire sauter les uns après les autres les rares verrous que comptait encore la première mouture du texte gouvernemental sur la fin de vie, FSSPX.Actualités propose une synthèse des contradictions internes dont fourmille le projet de loi.
Le simple rappel du commandement de Dieu « Tu ne tueras point », suffit à disqualifier, d’un point de vue moral et éthique, la dérive euthanasique inscrite dans le projet de loi sur la fin de vie. Mais mettre en relief ses contradictions internes permet de constater l’ineptie d’un projet qui ne peut même pas résister à de simples arguments ad hominem.
1ère contradiction : le texte gouvernemental, avec les ajouts de la commission spéciale parlementaire, rompt avec la tradition de suivre les orientations du Conseil consultatif national d’éthique (CCNE). Cet organe, pourtant connu pour son progressisme, préconise, dans le cadre de la fin de vie, de généraliser les soins palliatifs avant tout changement législatif. Le gouvernement propose l’inverse.
2ème contradiction : alors que la notion même de loi requiert que l’on nomme les actes tels qu’ils sont dans la réalité, et ce qu’ils représentent, l’acte d’assistance au suicide et l’euthanasie sont cachés derrière « l’aide à mourir », sous prétexte que c’est « simple et humain », et ils sont décrits comme des soins. Mais l’acte létal brise l’accompagnement et détruit la notion même de soin.
3ème contradiction : les Etablissements d’hébergement pour personnes âges dépendantes (EHPAD) souhaitent une mise en place plus systématique d’unités de soins palliatifs ; mais le projet de loi fait entrer de facto l’euthanasie dans les EHPAD, selon l’aveu de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, au deuxième jour des débats.
4ème contradiction : le projet de loi se fonde sur des critères éminemment subjectifs comme la « souffrance insupportable » et « la grave altération du discernement », alors que la « souffrance réfractaire » est capable d’évaluation médicale. Comment juger objectivement de ces éléments subjectifs ? Quant à l’issue fatale « à moyen terme », elle laisse perplexe tous les médecins…
5ème contradiction : le projet de loi veut promouvoir « l’autonomie du patient fragilisé » par un pronostic vital engagé à court ou moyen terme ; mais le prix de cette « autonomie » de mourir, détruit la liberté du personnel soignant, sommé de poser le geste létal. Y aurait-il des libertés qui valent plus que les autres ?
Finalement, selon Gènéthique, « tous les verrous » ont sauté : « le pronostic vital engagé, l’euthanasie par un proche acceptée, l’euthanasie considérée comme un soin, le volontariat refusé ». Patrick Hetzel, un député qui a combattu ces dérives ne peut retenir son émotion : « Le désarroi et l’inquiétude des soignants sont immenses, ce texte est le plus permissif au monde. »
Dans son essai magistral, La condition de l’homme moderne, Hannah Arendt fait une remarque qui éclaire le débat autour du projet de fin de vie : ce qui sape une communauté politique selon elle, c’est la « perte de puissance » qui se réalise lorsque la parole et les actes divorcent, lorsque « les mots ne révèlent plus des réalités, mais voilent et détruisent les intentions afin de créer des réalités nouvelles ». C’est alors, avance-t-elle, que la violence et la tyrannie se substituent à la paix publique.
On ne s’étonnera plus que le salon funéraire devienne bientôt le centre de gravité du macronisme, comme l’Eglise fut jadis le cœur battant de la cité.
(Sources : Gènéthique – FSSPX.Actualités)
Illustration : Photo 58743784 © Tomas1111 | Dreamstime.com