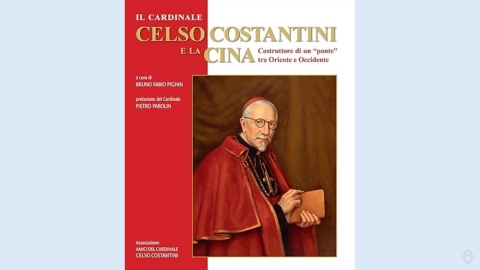CEDH : pas de droit au suicide assisté en Europe

La Cour européenne des droits de l’homme
Le Centre européen pour le droit et la justice (ECJL) publie un article détaillé de Grégor Puppinck sur un jugement rendu le 13 juin 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) portant sur la fin de vie. Il s’agit de l’affaire historique et médiatisée Karsai vs Hongrie. L’ECLJ est intervenu dans cette affaire et a été autorisé à soumettre des observations écrites.
Dániel Karsai est un avocat hongrois spécialisé en droit constitutionnel et en Droits de l’Homme, ancien membre de la CEDH. En 2022, à l’âge de 45 ans, on lui a diagnostiqué une Sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot). Il a intenté une action contre le gouvernement de Hongrie devant la CEDH pour pouvoir mettre fin à ses jours.
L’ancien juriste espérait que l’évolution de la jurisprudence pourrait lui reconnaître un « droit » au suicide assisté « au titre de la Convention européenne des droits de l’homme ». Selon l’ECJL, « sur la base des précédents de la Cour durant les quinze dernières années », cet espoir était fondé, mais il a été déçu. En effet, la Cour a confirmé ses mesures passées.
La question posée à la CEDH portait sur « l’éventuelle obligation des Etats de légaliser l’euthanasie et le suicide assisté en vertu du droit au respect de la vie privée », et sa réponse est négative. Les considérants sont intéressants : d’abord du fait « des implications sociales et des risques d’abus et d’erreurs que comporte l’assistance médicale à la mort [qui] pèsent lourdement dans la balance ».
De plus, elle a reconnu « la marge d’appréciation considérable » des Etats « compte tenu de la nature morale et éthique très sensible de la question et du fait que la majorité des Etats membres continuent d’interdire cette pratique en vertu du droit pénal ». Ce qui implique que les Etats « peuvent continuer à les interdire en droit pénal et peuvent même poursuivre les personnes impliquées dans ces pratiques à l’étranger sur leurs propres ressortissants ».
Enfin, « la Cour a souligné l’importance et la nécessité de “soins palliatifs de qualité” », qu’elle a décrits comme « essentiels pour assurer une fin de vie dans la dignité ». C’est la première fois que la « Cour met autant l’accent sur les soins palliatifs dans sa jurisprudence relative à la fin de vie et qu’elle les présente comme relevant des obligations positives des Etats », note Grégor Puppinck.
Des « droits de l’homme » qui doivent évoluer avec la société
La Cour a cependant conclu en affirmant que la question doit rester ouverte « compte tenu de l’évolution des sociétés européennes et des normes internationales en matière d’éthique médicale dans ce domaine sensible ». Ce qui laisse ouverte une possibilité future de juger différemment.
Grégor Puppinck commente : cela « illustre la tendance de la CEDH à se détacher du texte de la Convention et à juger en fonction de l’évolution de la législation, c’est-à-dire du mode de vie actuel ». Il poursuit : « Il est dangereux pour les droits de l’homme de voir leur contenu et leur protection dépendre de l’évolution des mentalités et des législations. »
Une « approche évolutive » qui va à l’encontre du rôle assigné aux droits de l’homme, « institués pour établir des principes intangibles permettant de juger de l’acceptabilité de diverses pratiques et législations », et pour fixer une limite aux pratiques et aux développements, même adoptés par une majorité, plutôt que de s’y conformer pour les consacrer.
Et il conclut : « L’approche évolutionniste adoptée par la Cour conduit à considérer que le suicide assisté est un droit de l’homme en fonction du nombre de pays qui l’ont légalisé, ce qui est philosophiquement absurde. »
De manière un peu surprenante, l’auteur ajoute que « si les Etats veulent faire de l’euthanasie et du suicide assisté un droit de l’homme garanti par la Convention européenne des droits de l’homme, il leur appartient de la modifier en conséquence. Eux seuls ont le droit légal de le faire, même si ce choix reste critiquable d’un point de vue éthique. »
Mais cette capacité évolutive, qui fait passer de l’interdit au permis une pratique condamnée par le droit naturel et par l’Eglise – interprète autorisé de ce droit naturel, et dépositaire de la révélation divine qui condamne cette pratique – montre la vacuité de ces « droits de l’homme ».
Le droit humain qui n’est pas adossé au droit divin – naturel ou révélé – est soumis aux bourrasques du siècle et tourne à tous les vents comme une girouette. Pie XII, dans son Discours aux membres de l’Institut international pour l’unification du droit privé, le 15 juillet 1950, l’explique avec sa profondeur et sa précision habituelles :
« Selon Platon, “Dieu est pour nous en première ligne la juste mesure de toutes choses, beaucoup plus qu’aucun homme ne peut l’être”. Cette pensée même, l’Eglise l’enseigne aussi, mais dans toute la plénitude et la profondeur de sa vérité, lorsque déclarant avec saint Paul que toute paternité dérive de Dieu (Ep 3, 15), elle affirme en conséquence que, pour régler les rapports mutuels au sein de la grande famille humaine, tout droit a sa racine en Dieu. »
(Sources : ECJL/Saint-Siège – FSSPX.Actualités)
Illustration : Photo 74606001 © Elena Duvernay | Dreamstime.com