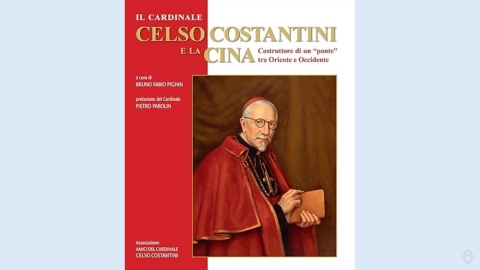Synode sur la synodalité : la synthèse nationale belge

L’épiscopat belge
La synthèse nationale envoyée à Rome par la Conférence des évêques de Belgique (CEB) à la suite des consultations réalisées de février à avril 2024, a été publiée le 16 mai : elle est sans surprise. En effet, en février dernier, l’épiscopat belge avait publié un projet des Priorités de discussions pour la deuxième session de la 16e Assemblée générale du Synode des évêques – octobre 2024.
Ce projet, articulé en trois points et trois thèmes, avait fait l’objet d’une analyse de FSSPX.Actualités : c’est sans doute le plus décapant présenté par des évêques dans le sillage du Synode. Le précédent article pourrait dispenser d’écrire celui-ci, mais certaines nouvelles idées apportées par les participants sont nouvelles, voire importantes à signaler.
« Introduction : méthode de consultation et contexte belge »
Ce contexte, explique la CEB, est particulièrement celui des abus. Dans cette perspective, les évêques expliquent qu’ils « sont déterminés (…) à voir dans la réflexion sur la synodalité un bon moment pour relever le défi plus fondamental de la gestion du pouvoir ». L’un des point centraux du Chemin synodal allemand, faut-il le rappeler.
Dans cette visée, « promouvoir une Eglise synodale, travaillant sur la prise de décision participative pour relever les défis de la mission et des abus est non seulement crucial mais urgent ». D’où les trois priorités et les trois thèmes.
« I. Trois priorités pour la session du Synode d’octobre 2024 »
1. Une Eglise missionnaire en dialogue avec le monde
La réflexion découvre qu’une « Eglise missionnaire synodale exige un dialogue ouvert qui tienne compte des développements actuels du monde qui nous entoure. L’Eglise ne peut pas se limiter à une communication à sens unique dans la proclamation de la Bonne Nouvelle au monde ».
Dan un « dialogue ouvert, l’Eglise écoutera aussi ce que l’évolution des sciences, de la culture et de la société peut lui apprendre. (…) Un dialogue ouvert avec le monde est nécessaire à partir de la conviction profonde que l’Esprit de Dieu y est mystérieusement à l’œuvre. »
« Dans un tel dialogue, l’Eglise peut aussi apprendre des choses. Les évolutions sociétales (concernant les droits de l’homme, la démocratie et les libertés modernes, par exemple) incitent également à revoir et/ou à enrichir certaines de ses position », note encore la synthèse
Le texte continue : « Une conversation ouverte et respectueuse avec le monde contemporain offre à l’Eglise la possibilité de se remettre en question et de renouveler sa propre compréhension de la Bonne Nouvelle ». C’est la demande qui conclut ce point : « que la culture de l’écoute réciproque soit utilisée pour entrer en dialogue avec les développements actuels dans le monde qui nous entoure ».
Ces réflexions suggèrent que l’Eglise n’est pas détentrice de la Vérité, qui est Jésus-Christ. Mais aussi qu’il faut se mettre à l’écoute du monde moderne, en oubliant qu’il inspire les lois mauvaises (avortement ou euthanasie), au lieu de le convertir. Enfin l’appel aux « libertés modernes » qui sont sans cesse utilisées contre le droit naturel, ne semblent pas faire peur aux catholiques belges.
2. Une compréhension dynamique de la Tradition
« Dans le cadre du dialogue de l’Eglise et du monde, l’Eglise doit avoir le courage de mettre sa Tradition (…) en dialogue avec l’état actuel de la recherche théologique, philosophique et scientifique. (…) Elle est le fruit de nombreux développements et elle continue à évoluer. »
D’où la demande : « que le Synode définisse notre ou nos Tradition(s) ecclésiale(s) comme dynamique(s) et en développement constant. A partir de là, la Tradition peut être relue en dialogue avec les développements récents de la théologie, de la philosophie et des sciences. » Pour cette fausse notion de la Tradition, lire la conclusion de cet article.
3. Unité dans la diversité et responsabilité
Le chapitre demande une clarification des responsabilités à tous les niveaux de l’Eglise : « Qu’est-ce qui peut-être décidé concrètement par un évêque, une conférence épiscopale ou une assemblée épiscopale continentale ? » ; cette interrogation est basée sur la synthèse synodale d’octobre 2023.
Constatation : « Un fonctionnement plus synodal avec une participation croissante de nombreuses personnes à la délibération et à la prise de décision exige une plus grande reconnaissance de la diversité légitime et une application renouvelée de la subsidiarité. » Puis les demandes s’enchaînent.
« Certains groupes ont clairement demandé que l’on étudie et développe davantage la possibilité d’un “conseil pastoral national”. (…) Certains ont demandé la création d’un organe de consultation et de décision à l’échelle de l’Europe occidentale composé d’évêques et de laïcs. »
D’où la demande conclusive : « Nous demandons une concrétisation de la “responsabilité” des évêques et autres responsables pastoraux dans une Eglise synodale. »
Le Chemin synodal allemand a largement déteint en Belgique, et il est même dépassé. Ce qui est demandé est un « Conseil synodal » – celui qui a été refusé par Rome aux Allemands, au moins partiellement – qui irait jusqu’au niveau supranational. Autant dire que le pouvoir des évêques, donné par Jésus-Christ, serait singulièrement diminué.
« II. Trois thèmes concrets »
A. La place des femmes dans l’Eglise
Les développements dans la société civile « renforcent la compréhension du Nouveau Testament de l’égalité des hommes et des femmes dans le Christ ». Ainsi, nombre des consultés « sur la base du sacrement du baptême » demandent « une plus grande participation des femmes à la prise de décision dans l’Eglise ».
Ce qui se décline dans la participation au sacrement de l’ordre : « La question se pose de savoir si les femmes peuvent être également être admises au ministère diaconal, ce qui permettrait de restaurer une ancienne Tradition. »
Par analogie avec la restauration du diaconat permanent par Vatican II « nous demandons, à partir des consultations en tant qu’Eglise belge, de rétablir également le diaconat permanent pour les femmes. Dans notre analyse, conférer de grandes responsabilités pastorales aux femmes et l’ordination diaconale ne devrait pas être universellement obligatoire ou interdit. »
Enfin, « au cours de nos consultations, certains groupes ont clairement appelé à aller plus loin et à rendre négociables les ordinations sacerdotales et épiscopales pour les femmes ». La synthèse admet cependant : « C’est une demande qui revient régulièrement chez certains croyants en Belgique, alors que d’autres y sont fortement opposés. »
Toutes ces demandes vont contre la constitution divine de l’Eglise, mais les évêques les ont signées : il n’y a jamais eu de diaconesses ordonnées ; il n’y a jamais eu de diaconat permanent avant Vatican II ; la possibilité de recevoir le sacrement de l’Ordre, à tous ses degrés (diaconat, sacerdoce, épiscopat), est réservé aux hommes. Il n’y a rien à dire de plus.
B. Place et signification du ministère ordonné dans une Eglise synodale
Deux éléments font difficulté : le cléricalisme et l’obligation du célibat pour les prêtres. C’est pourquoi « en tant qu’Eglise belge, nous demandons que, par conférence épiscopale ou assemblée épiscopale continentale, il soit permis de pouvoir prendre certaines mesures afin d’ordonner des “viri probati” ». Cette ordination ne doit pas être universellement obligatoire ou interdite ajoute le texte.
Il est aussi demandé « de confier une responsabilité pastorale finale aux laïcs formés. Parmi les laïcs qui accompagnent comme aumôniers les malades, il y a une demande spécifique de pouvoir recevoir un mandat de l’évêque pour administrer le sacrement des malades. »
Cette dernière demande est une nouvelle aberration : il faut le caractère sacerdotal pour administrer l’Extrême-Onction. Le sacrement de l’Ordre ne peut pas être démembré et distribué par morceaux. Le fait d’avoir permis l’impression d’une telle erreur montre la méconnaissance complète de la foi catholique chez les rédacteurs.
Le troisième thème porte sur « Les jeunes et la culture numérique » et ne pose pas de difficulté.
Conclusion
La synthèse nationale belge ne parle plus de l’Eglise catholique, mais d’un vague protestantisme dans lequel la Tradition divine peut être réinterprétée selon la mode du jour. Les rédacteurs croient être malins en précisant de manière répétée que leurs demandes « ne doivent pas être universellement obligatoires ou interdites », pour éviter de se confronter à d’autres épiscopats.
Ils ne réussissent qu’à montrer leur totale soumission à l’esprit du monde, leur seul guide. Le monde dont ils parlent a fait plonger la société belge dans les plus terribles divagations morales. Mais ils s’accrochent aux « évolutions sociétales » de manière (très) sélective. Et ils voudraient voir l’Eglise plonger dans cette folie universelle « pour se montrer missionnaire » dans le monde d’aujourd’hui.
La seule conclusion à donner est de reprendre Notre Seigneur : « Laissez-les ; ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse » (Mt 15, 14).
(Source : CathoBel – FSSPX.Actualités)
Illustration : CathoBel